Le défi de l’observation de la renaturation : retour d’expérience à partir de l’utilisation du Mode d’Occupation des Sols et de l’Occupation des Sols à Grande Échelle en Île-de-France
Dossier FNAU (Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme) n°64
Jean Bénet, Damien Decelle, juin 2025
Institut Paris Région (IAU), Agence pour l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
À l’heure de l’objectif national « zéro artificialisation nette », ralentir l’urbanisation et renaturer les milieux urbains deviennent deux stratégies incontournables et complémentaires. Les territoires se sont engagés dans la lutte contre le changement climatique, à travers l’adoption de son « Plan d’adaptation au changement climatique » (PRACC) pour préparer le territoire francilien aux évolutions tendancielles du climat et le protéger des aléas climatiques extrêmes. Cette adaptation passe par un déploiement des solutions fondées sur la nature, dont la renaturation des espaces minéralisés en milieux urbains. Zoom sur le cas de la Région Île-de-France
À télécharger : fnau-64-institut_paris_region.pdf (190 Kio)
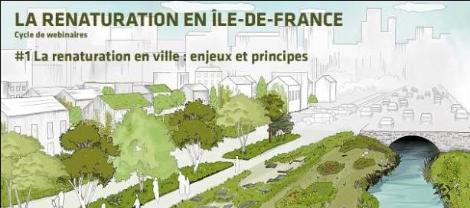
L’observation de l’artificialisation et de sa symétrie, la renaturation, au coeur de la mise en oeuvre de l’objectif ZAN
L’atteinte de l’objectif « Zéro Artificialisation Nette » s’appuie sur une mise en oeuvre en cascade depuis l’échelle nationale jusqu’à l’échelle locale à travers les documents d’urbanisme, à l’opposé d’une approche par le projet qui impliquerait que chaque opération impactant les sols doive compenser l’artificialisation générée. Le corollaire est la capacité à suivre le respect des objectifs de réduction de l’artificialisation, décennie par décennie, à l’aide d’outils d’observations. Ce suivi est une exigence réglementaire, qui se traduit à la fois par le bilan du document d’urbanisme – devant être réalisé tant pour les PLU(i) et les SCoT, que les schémas régionaux – et le rapport triennal de suivi de l’artificialisation. Un dérapage de l’artificialisation observée par rapport à celle prévue est ainsi susceptible d’entrainer la révision du document d’urbanisme afin de remettre le territoire sur la bonne trajectoire. Si la définition et les outils permettant de suivre l’artificialisation (et dans un premier temps, la consommation d’espace) ont fait couler beaucoup d’encre, la question de la renaturation a peu été abordée. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cela : d’une part l’atteinte du ZAN repose avant tout sur des efforts de sobriété foncière, c’est-à-dire de réduction de l’artificialisation, d’autre part, la renaturation étant appréhendée comme un processus symétrique à l’artificialisation, son suivi suit les mêmes principes. Toutefois, le caractère récent de cette notion et les exemples encore peu nombreux d’opérations sous-tendent un manque de recul quant au suivi de la renaturation et soulèvent des questions :
• Quelles sont les dynamiques actuelles de renaturation, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif ?
• Les outils existants permettent-ils de mesurer de façon satisfaisante ce processus ? Les premiers éléments de comparaison des deux bases de suivi de l’occupation des sols en Île-de-France – Le Mode d’Occupation des Sols et l’Occupation du Sol à Grande Échelle – permettent un début de réponse à ces questions. Ce travail met en avant une renaturation en trompe l’oeil d’un point de vue quantitatif, et peu satisfaisante d’un point de vue qualitatif, soulignant une nécessaire évolution des outils, mais également une contribution potentiellement restreinte de la renaturation à l’atteinte du Zéro Artificialisation Nette en comparaison des dynamiques actuelles d’artificialisation.
Une mesure de la renaturation en trompe l’oeil en île-de-france à partir du mos et de l’OCSGE
La renaturation s’établit de 2017-2018 à 2021 en Île-de-France entre 279 hectares (soit 8% de la consommation d’espace observée par le MOS) et 666 hectares (19% de l’artificialisation observée par l’OCSGE). Si ces écarts de chiffres peuvent être attribuées pour partie à la nuance de définition de la renaturation entre l’approche « consommation d’espace » et l’approche « artificialisation », et aux différences méthodologiques entre les deux outils, le MOS et l’OCSGE présentent des limites communes pour l’observation de la renaturation. En effet, près de 60% de la renaturation repérée par le Mode d’Occupation des Sols est liée à l’origine à un usage transitoire des sols, qu’il s’agisse de la remise en état d’emprises de chantiers, d’entreposage à l’air libre (souvent liée aux activités agricoles), ou encore d’installations de stockage des déchets. Le décompte de la renaturation de ces dernières à l’issue de leur remplissage interroge, alors qu’elles sont essentiellement développées au sein des ENAF et que leur remise en état est une exigence dès leur ouverture : leur renaturation compense donc leur propre création, à l’image du statut particulier des installations d’extraction des matériaux dans le décompte de l’artificialisation. Pour l’OCSGE, c’est près de 37% de la renaturation observée qui a lieu sur des espaces considérés comme « zones en transition ». Une part majoritaire de ces zones en transition sont considérées comme renaturées car elles rejoignent la catégorie « sans usage » 1 de l’OCSGE, qui, tous flux de confondus, représente 38% de la renaturation observée. Davantage qu’une véritable renaturation, il s’agit ici d’un biais de nomenclature qui assimile les espaces sans usage à végétation basse à des espaces non artificialisés, quand bien même cette catégorie traduit souvent un défaut d’information temporaire sur l’usage d’un espace : il peut s’agir par exemple d’un terrain aménagé dans une ZAC au sein duquel les travaux de construction n’ont pas commencé, un espace « renaturé », appelé à être « ré-artificialisé » par la suite. Près d’un tiers de la renaturation observée dans le MOS concerne des espaces ouverts urbains (parcs, jardins, délaissés d’infrastructures, terrains vacants), traduisant des dynamiques d’enfrichement spontané, mais également l’ambiguïté du classement de certains espaces ouverts à végétation basse (ex : abords des pistes des aéroports et aérodromes, friches végétalisées en milieu urbain). Si ces observations témoignent dans de nombreux cas de la progression de la naturalité de ces espaces, il est difficile de définir de façon homogène le temps nécessaire ou le point de bascule pour qu’une telle renaturation soit effective, ou encore de s’assurer de l’amélioration de fonctionnalité des sols concernés. 38% de la renaturation observée à l’OCSGE en Île-de-France concerne des surfaces pouvant être considérées comme de « pleine terre » à l’origine, que cette renaturation implique une progression du couvert végétal (passage d’une végétation basse à végétation haute au sein des espaces urbanisés : 18% des renaturations observées), une évolution de l’usage (avec le rôle disproportionné du « sans usage » pour des surfaces à végétation basse), ou les deux. Ce constat renvoie aux mêmes difficultés de classification des espaces ouverts à végétation basse que le MOS, toutefois accentuées par le croisement couverture/usage de la nomenclature de l’artificialisation. Dans l’ensemble, que ce soit dans le MOS ou l’OCSGE les actions de renaturations observées impliquant la démolition d’un bâtiment ou une désimperméabilisation des sols sont extrêmement rares et quantitativement négligeables à l’échelle régionale.
Une voie à trouver entre nécessaire fiabilisation des outils et approche par le projet
Si la lecture des chiffres bruts de renaturation du MOS et de l’OCSGE laisse entrevoir une contribution quantitative potentiellement non négligeable de la renaturation à l’atteinte du ZAN en Île-de-France, une analyse plus attentive de ces bases de données dessine un autre tableau : l’artificialisation nette apparente est davantage la mesure de l’artificialisation débarrassée du « bruit » des usages temporaires des sols, qu’une véritable différence entre des flux d’artificialisation et de renaturation pérennes. L’essentiel du reste de la renaturation observée concerne des sols de pleine terre à l’origine, via un processus d’enfrichement ou d’« effets nomenclature » pour lesquels l’amélioration de la fonctionnalité n’est pas garantie. Ces premières observations dessinent plusieurs voies pour sortir de l’ornière :
• une nécessaire fiabilisation des outils, quant aux effets « yoyo » de la classification des occupations temporaires des sols, mais également concernant la classification des espaces ouverts à végétation basse (friches urbaines, délaissés, terrains vacants) ;
• la diffusion de précautions d’usages à l’utilisation des bases de suivi de l’évolution de l’occupation des sols, qui doivent rester des outils et nécessitent analyses et corrections pour se rapprocher de la réalité du territoire ;
• une certaine souplesse dans l’application du ZAN, qui doit partir du projet de sobriété foncière et de restauration des sols du territoire davantage que des outils d’observation.
-
1 Alors que l’ensemble des surfaces à couverture végétale non ligneuse et usage résidentiel, de réseaux de transports logistique, d’infrastructure et de production secondaire ou tertiaire sont considérées comme artificialisées, ces mêmes surfaces sont considérées comme non artificialisés si elles sont “sans usage” ou à “usage inconnu” selon le tableau de croisement d’usage et de couverture correspondant à l’artificialisation pour l’OCSGE.